Nord perdu est un recueil d’essais sur l’exil, une réflexion sur l’éloignement et la décentration. Ne plus être tout à fait soi, ne plus être que soi. Nancy Huston est originaire de Calgary. Cette ville est son Nord intime, le point cardinal enneigé de son existence. L’auteure y a vécu son enfance avant de vivre son adolescence aux États-Unis. Toutefois, dans ses essais, elle parle essentiellement d’un autre éloignement, plus tardif, plus radical également, celui qui l’a conduite, jeune femme, de l’autre côté de l’Atlantique. Nancy Huston vit depuis de nombreuses années en France. Dans Nord perdu, elle valorise l’exil en tant qu’expérience intellectuelle, d’un point de vue linguistique ou encore culturel. Elle insiste sur l’idée que l’exil fait partie intégrante de l’histoire et de l’expérience humaine. Nier cette évidence, c’est refuser de regarder la réalité en face. Jorge Calderón résume très bien l’analyse de Huston : « Les Canadiens comme les Mexicains, les Argentins, les Brésiliens, et ainsi de suite, doivent faire preuve de foi en la fiction de la nation s’ils désirent cacher, rejeter et refouler leur condition d’exilés » (Calderón, 2007, p. 12).
Pour ma part, je comprends et j’accepte ce raisonnement. Toutefois, il y a deux exils chez Huston, l’éloignement du pays, de la culture d’origine, et l’éloignement du territoire de l’enfance. L’un est clairement intellectuel, l’autre affectif. Ces deux exils s’articulent finement dans les propos de Huston, mais l’un peut-il consoler l’autre ?
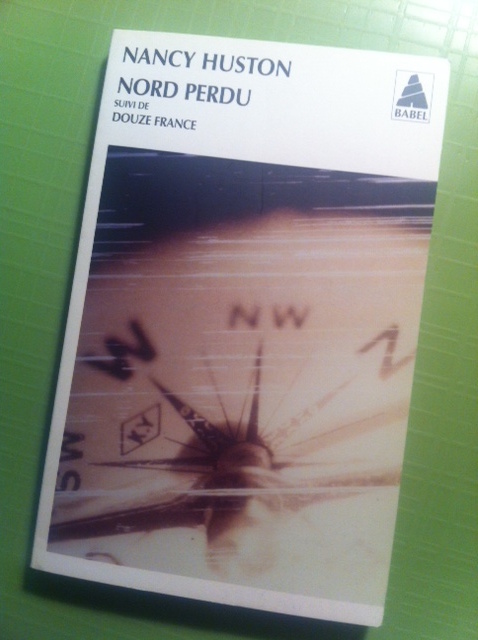
« L’exil géographique veut dire que l’enfance est loin: qu’entre l’avant et le maintenant, il y a rupture ». (p.20)
Je travaille dans le domaine de la didactique des langues. Mon activité est destinée, directement ou non, à des immigrés adultes et à des enseignants dont certains sont également immigrés. Je participe très activement à la création de projets qui peuvent aider les enseignants de français langue seconde des communautés francophones isolées. D’un point de vue intellectuel, je suis la première à mettre en lumière la diversité des publics et des professionnels qui les accueillent, à valoriser l’expérience de l’exil, mais cela ne peut pas me « réparer » complètement. J’ai besoin d’autre chose, quelque chose qui parle à mon enfance, à cette terre que mon grand-père paternel a léguée à mon père pour que celui-ci, avec ma mère, y construise sa maison. Il manque une dimension affective consolatrice, que je ressens dans mon activité, une dimension que j’ai longtemps eu du mal à m’expliquer.
Je suis attirée comme un aimant par ceux qui ont perdu leur territoire, immigrants, mais aussi communautés francophones isolées comme l’a exposé François Paré dans La Distance habitée. Ils sont des orphelins du territoire. Leur milieu de vie est ou est devenu essentiellement celui de l’Autre, dont la voix domine. Contrairement à de nombreux immigrants, je n’ai jamais eu besoin de me rapprocher de ma communauté d’origine, d’intégrer une « petite France » dans mon nouveau pays pour me réchauffer ou faire corps contre l’Autre. J’ai eu besoin de me rapprocher d’une communauté aux frontières intellectuelles plus souples, une communauté plus métissée, plus créative aussi, celle des orphelins du territoire. Cette attirance pour eux, je ne l’ai pas connue simplement avec l’immigration. Lors de mes études universitaires, ma grande amie Geneviève et moi étions essentiellement entourées d’étudiants étrangers de passage en France. Ils avaient perdu certains repères. Une partie d’entre eux allaient repartir, d’autres souhaitaient rester. À cette même époque, je choisissais de faire une étude sur Jeanne Castille de Louisiane qui a consacré sa vie à la défense du français en Louisiane. J’ai entrepris des démarches pour partir travailler là-bas, mais elles ont échoué. Cette affinité, donc, est ancienne.
Toutefois, je dois pousser mon introspection plus loin. Les voyages de mon enfance sont gorgés de souvenirs extraordinaires. Jeune fille, j’ai vécu un an aux États-Unis entre deux années d’études universitaires. Une partie de ma formation fut consacrée de façon déterminante à la didactique du français langue étrangère, discipline qui m’ouvrait facilement les portes de l’exil, tradition française oblige. Mon rapport à l’ailleurs est ancien, profond et peut-être tout aussi déterminant que mon rapport à l’ici, territoire de mon enfance. Mon premier séjour au Québec, à dix-neuf ans a joué un rôle très important dans mon imaginaire d’écrivaine en devenir. J’en ai parlé dans d’autres billets, Ailleurs ou encore récemment Liban.
Je constate que certaines décisions personnelles et professionnelles scintillent aujourd’hui doucement comme un trésor longtemps caché. Un trésor de complexité qui habite chacun d’entre nous. Malgré tout, la vérité est peut-être ailleurs. Dans ce Dictionnaire mélancolique de mon exil, je ne raconte pas mon histoire. Je partage une certaine construction discursive de mon expérience. Je reconstruis mon histoire. Ce trésor de complexité qui me permet de concilier l’inconciliable et de rationaliser a posteriori mon parcours, ce trésor-là, je le construis peut-être de toutes pièces sous les yeux du lecteur, comme un outil de résilience.
Finalement, que serait devenue Nancy Huston si elle était restée vivre en Alberta? Elle l’imagine dans Nord perdu. L’auteure imagine d’autres vies que celle qu’elle a vécue. Tout exilé a rêvé un jour de posséder le don d’ubiquité. Hélas, seule notre imagination nous transporte… Que serions-nous devenus si nous étions restés? Mais la question a son revers : que ne serions-nous pas devenus?
Jorge Calderón, 2007 : « Où est l’Ouest dans Nord perdu de Nancy Huston ? », dans Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, vol. 19, numéro 1, p. 9-25.
Jeanne Castille, 1984 : Moi, Jeanne Castille, de Louisiane, Luneau Ascot Éditeurs.
Nancy Huston, 1999 : Nord perdu suivi de Douze France, Actes Sud.
François Paré, 2003: La Distance habitée, Le Nordir.






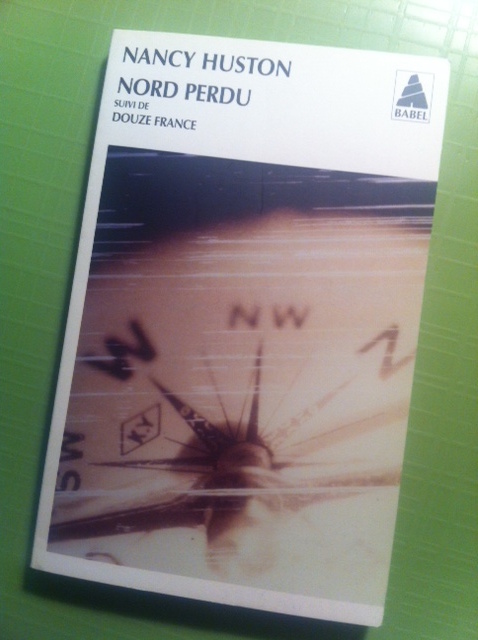


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.